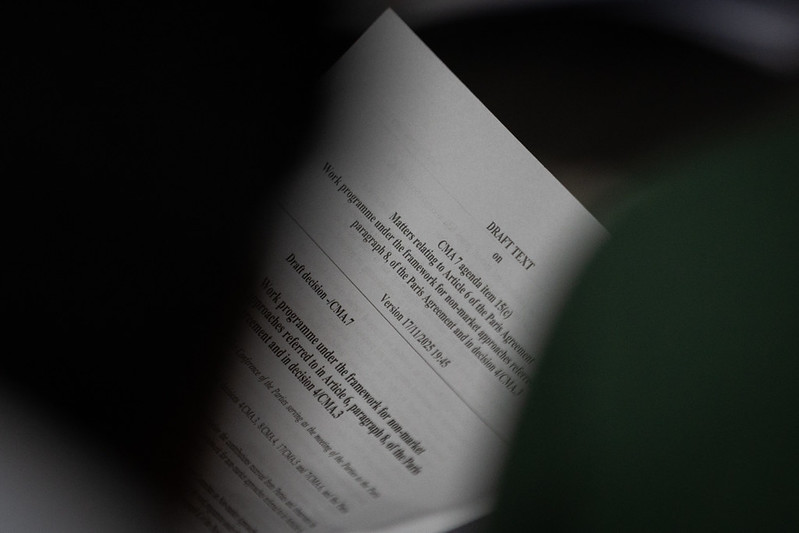COP30 : L’Afrique demande l’équité et des investissements climatiques
COP30 : L’Afrique demande l’équité et des investissements climatiques
Par Alpha Oumar Kaloga, Négociateur en Chef du Groupe Africain sur les questions Pertes et préjudice et finances climatiques

Dix ans après l’Accord de Paris, la Conférence des Parties (COP30), prévue à Belém du 10 au 21 novembre 2025, met en lumière une urgence scientifique et politique. En 2024, la température mondiale moyenne a dépassé le seuil de +1,5 °C. Parallèlement, plusieurs « limites planétaires » ont été franchies. Le message est clair : le système multilatéral doit évoluer d’une approche de promesses à une approche de preuves. Dans ce cadre, l’organisation de la COP en plein cœur de l’Amazonie revêt une signification symbolique — cependant, la légitimité de l’exercice sera évaluée à travers des décisions chiffrées, datées et financées.Dans ce cadre, l’organisation de la COP en Amazonie revêt une signification symbolique. Toutefois, la légitimité de l’exercice sera évaluée à travers des décisions chiffrées, datées et financées
Pour l’Afrique, où le réchauffement progresse près de 1,5 fois plus rapidement que la moyenne mondiale, la question n’est pas seulement diplomatique : elle est existentielle. La vulnérabilité structurelle — dépendance à l’agriculture de pluie, insuffisances d’infrastructure, pression de la population, exposition sur le littoral — s’associe à des marges budgétaires restreintes. Le continent espère de Belém un tournant : passer de la rhétorique de la vulnérabilité à la reconnaissance d’un rôle d’architecte de la transition, basé sur des priorités définies — ambition climatique, financement durable, et compensation des pertes et dommages.
Ambition climatique : De l’annonce des objectifs à la mise en œuvre mesurable
L’année 2025 représente la date limite pour le dépôt de la troisième génération de Contributions Déterminées à l’Échelle Nationale (CDN 3.0). À la mi-octobre, seulement un tiers des Parties avait effectivement soumis sa mise à jour — 62 sur 194 — indiquant un ralentissement du « cycle d’ambition ». Le Groupe africain des négociateurs (AGN) n’exige pas une surtransposition ou transfert de fardeau -des obligations d’atténuation aux économies historiquement à faibles émissions. Il requiert, en revanche, que les CDN 3.0 :
1 traduisent le bilan planétaire en voies sectorielles réalistes (énergie, transport, construction, AFOLU) ;
2 précisent les objectifs 2026-2030 (capacités renouvelables, empreinte carbone de l’électricité, standards d’efficacité) ;
3 incorporent des objectifs solides d’adaptation en accord avec l’Objectif mondial d’adaptation (GGA), accompagnés d’indicateurs quantifiables ;
4 définissent les exigences de réalisation (financement, technologies, développement des compétences), quantifiées et surveillées.
En Guinée, la nécessité des impacts rend l’implémentation inéluctable. De l’ érosion côtière intensifiée à Kabak et Kakossa, la fluctuation accrue des pluies dans le grand Conakry, Mafereinya, Fouta Djallon, en passant par la diminution de la productivité agricole due à la dégradation des sols et à l’irrégularité des saisons. Chez nous , en effet, l’ambition « pragmatique » implique de combiner :
1 un renforcement des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire décentralisé) ;
2 des méthodes d’agriculture résiliente au climat (variétés résistantes, gestion de l’eau, services climatiques) ;
3 une planification spatiale qui prend en compte le risque d’inondations et d’intrusion saline.

Le NCQG: Combler l’écart de financement climatique
Le New Collective Quantified Goal (NCQG) ou Nouvel Objectif Quantifié de la Finance doit satisfaire le besoin réel. À Bakou l’année dernière, les Parties ont établi un nouvel objectif collectif quantifié de 300 milliards USD par an d’ici 2035 pour les nations en développement. Cette échelle représente un progrès politique — cependant, elle reste bien en deçà des besoins globaux, estimés à environ 1 300 milliards USD/an pour maintenir la compatibilité avec les trajectoires de 1,5–2 °C et améliorer l’adaptation. En d’autres termes, le NCQG n’a de valeur que s’il active un levier de crédibilité : un plan de montée en puissance vers 1,3 trillion USD/an, accompagné de délais intermédiaires et de responsabilités partagées mais distinctes. Pour une finance équitable et transformationnelle, quelques principes cardinaux doivent être pris en compte :
1 Primat des subventions et des concessionalités. Les prêts classiques creusent l’endettement et disqualifient l’adaptation locale. Les guichets doivent privilégier des dons et instruments mixtes à forte concessionalité, avec des critères de vulnérabilité.
2 Réduction du coût du capital. Aujourd’hui, le coût du capital en Afrique figure parmi les plus élevés au monde, rendant non bancables des projets pourtant viables. Il faut des garanties souveraines et de portefeuille, une meilleure reconnaissance des institutions financières africaines (statut de créancier privilégié) et l’alignement prudentiel des banques multilatérales pour démultiplier l’effet de levier.
3 Accès direct et décentralisation. Les fonds doivent être accessibles aux entités nationales et infranationales via des procédures proportionnées au risque, avec des pipelines de projets locaux prêts à financer.
Vers une réforme de l’architecture financière ?
L’amélioration de la gouvernance financière passe par une meilleure représentation africaine dans les banques multilatérales (conseils et comités de risque), l’uniformisation des normes fiduciaires et l’introduction de dispositions de « pause-climat » dans la dette souveraine. Une refonte de l’architecture financière est nécessaire pour déclencher un changement de paradigme, alignant à terme tous les flux de capitaux sur l’objectif de 1,5 degré sans imposer de nouvelles conditions d’accès aux financements climato-compatibles.
Au-delà des ressources publiques, l’Afrique à travers ses négociateurs insiste sur des mécanismes novateurs : contributions et solidarité internationale : en taxant par exemple les billets d’avion, ou les grandes fortunes et certains types de transaction financière, un appui pour des obligations vertes d’État soutenues par des garanties multilatérales, et collaborations public-privé « orientées-impact » avec des conditions de partage des risques. L’Afrique devrait promouvoir activement des mécanismes de conversion de dettes en investissements climatiques (“debt-for-climate swaps”) comme instrument stratégique de justice financière et de relance durable.
Quels sont les besoins d’investissements immédiats en Guinée ?
En Guinée, les besoins d’investissement immédiats se concentrent sur quatre domaines clés pour stimuler la résilience et le développement durable :
Gouvernance Locale : Renforcement des capacités de planification territoriale, de suivi-évaluation des projets et de la transparence des flux financiers au niveau des collectivités.
Gestion Intégrée du Littoral : Financement d’infrastructures côtières résilientes (ouvrages de protection souples, restauration des écosystèmes) et de systèmes d’alerte précoce.
Résilience Eau et Agriculture : Développement de la sécurité hydrique et alimentaire via des projets d’irrigation efficace, la construction de petits barrages, des aménagements anti-érosion et l’amélioration des services climatiques.
Énergie Propre et Accès Rural : Accélération de la transition énergétique par l’optimisation de l’hydroélectricité existante et le déploiement de mini-réseaux solaires pour l’électrification des zones rurales.

Le fonds pour les pertes et dommages toujours en déficit
Le Fonds pour pertes et préjudices, validé politiquement à la COP28 et ensuite « opérationnalisé » à la COP29, souffre d’un faible financement. Les promesses de financement s’élèvent à moins d’un milliard de dollars, un montant dérisoire comparé aux décaissements réels nécessaires pour couvrir les pertes et dommages.. Cependant, les pertes irréparables — vies humaines, terres devenues incultivables, écosystèmes anéantis, héritage culturel — ne sont pas liées à l’atténuation ni à l’adaptation. Elles évoquent des transferts budgétaires supplémentaires, instantanés et sans création de dette. À la COP30 l’Afrique a quatre demandes pour abonder ce nouveau fonds de capital nécessaire et en adéquation avec le besoin croissant :
• Additionnalité et prévisibilité des ressources, hors re-fléchage de l’aide existante ;
• Accès direct et injection budgétaire comme réponse rapide au choc climatique pour les pays et, lorsque pertinent, pour les entités infranationales et communautaires ;
• Critères d’éligibilité clairs couvrant événements extrêmes et processus lents (érosion, salinisation, désertification, montée des mers) ;
• Gouvernance inclusive intégrant des représentants des pays bénéficiaires et des parties prenantes (dont femmes et jeunes) dans les comités décisionnels.
Priorités de la Guinée face aux pertes et préjudices
En Guinée trois priorités pour prévenir minimiser et répondre aux pertes et préjudices associés avec les changements climatiques :
1. Protection du Littoral Guinéen : Financer des digues anti-sel, permettre des relocalisations dignes des communautés vulnerables, des protections côtières écocompatibles, et la restauration de mangroves comme infrastructures naturelles de défense ;
2. Comprendre les impacts sur les chaînes de valeur agricoles : Indemniser les pertes de récolte, refinancer les actifs productifs, sécuriser l’accès à l’eau et aux semences tolérantes ;
3. Cohésion sociale et capital humain. Appuyer les programmes d’aide psychosociale, d’assurance inclusive et de relance micro-entrepreneuriale, avec une participation centrale des femmes — souvent premières gestionnaires de l’eau et de l’alimentation — et des jeunes.
L’Afrique prend les reines
L’objectif est double : réparer ce qui ne peut être « adapté » et, simultanément, éviter que la réparation ne recrée des vulnérabilités par des reconstructions inadaptées (« build back better, climate-proofed »).La transformation verte passe forcément la transition et une décarbonisation de nos économies. L’Afrique doit se démarquer de sa fragilité aux chocs exogènes à travers une autonomie financière et une adaptation de son écosystème financier. La Deuxième Conférence africaine sur le climat (ACS2) a symbolisé un tournant dans le discours : l’Afrique ne se limite plus à demander, elle offre et finance. Ainsi, industrialiser la résilience requiert l’incorporation de l’adaptation au centre des politiques de production : irrigation efficace, transformation agro-alimentaire bas-carbone, infrastructures résilientes, données climatiques et services numériques, standardisation des matériaux d’origine biologique. Cette méthode convertit des dépenses en actifs générateurs de valeur.
Ceci est le fondement de l’autonomie économique et environnementale. Toutefois, l’Afrique doit aussi affirmer clairement que toute taxation unilatérale de l’empreinte carbone de ses industries extractives ne peut en aucun cas restreindre son droit légitime au développement. Ces mécanismes doivent respecter l’équité et les responsabilités communes mais différenciées, ainsi que le principe d’additionnalité. Ils doivent être concertés, transparents et reconnaître les trajectoires nationales de décarbonation, pour éviter la double comptabilisation et les fuites de carbone. L’objectif est un développement durable et sobre en carbone, soutenu par des incitations et des financements adaptés, et non entravé par des pénalisations asymétriques.
Pour un marché du carbone fiable
La participation de l’Afrique à l’approvisionnement mondial en minéraux stratégiques (bauxite et fer manganèse, cobalt, platinoïdes, graphite,) ne doit pas reproduire l’extraversion passée. Le cadre d’une transition équitable inclut : création de valeur locale (raffinage, matériaux pour batteries), standards environnementaux et sociaux élevés, ainsi que des contrats justes respectant le contenu local.
Dans les sphères techniques les récents débats sont centres sur comment s’affranchir de la fragmentation à la norme africaine du marché carbone. Le potentiel des solutions basées sur la nature et des énergies renouvelables nécessitera un marché du carbone fiable, axé sur l’intégrité et les avantages locaux. Afin d’y parvenir, l ’Afrique inclue la Guinée doit : i) créer des cadres nationaux cohérents ; ii) instaurer une régulation continentale pour la qualité et des prix minimums ; iii) relier les mécanismes volontaires à l’Article 6 (transferts d’unités entre pays), pour prévenir la « vente à bas prix » d’actifs carbone et optimiser les co-bénéfices (biodiversité, inclusion, emplois).
La Guinée, riche en ressources forestières et en eau, peut établir un ensemble d’actifs de grande qualité (énergie hydro renouvelable, mangroves rétablies, agroforesterie) afin d’attirer des financements basés sur la performance. La crédibilité repose sur : des cadres juridiques précis, des systèmes MRV (mesure-rapportage vérification) compatibles, des registres accessibles au public, et des vérifications indépendantes. En Guinée, l’implantation locale — municipalités, établissements universitaires, organismes techniques — est essentielle pour créer des pipelines « rentables » et diminuer le risque d’exécution.
Qu’attendre de la COP 30 ?
L’évaluation de la COP30 portera non sur l’éloquence de ses déclarations, mais sur trois réalisations concrètes:
Des CDN 3.0 intégrales, en adéquation avec 1,5–2 °C, accompagnées de repères sectoriels 2026-2030 et de stratégies de mise en œuvre basées sur le bilan mondial.
Financement fiable et abordable. Une route chiffrée vers 1,3 trillion USD/an d’ici 2030, intégrant des subventions augmentées, un coût du capital réduit en Afrique, des garanties de portefeuille et un accès direct, accompagnée d’une gouvernance réajustée des banques multilatérales.
Un fonds pour les pertes et préjudices, supplémentaire, rapide, sans générer de dettes, visant à financer des relocalisations dignes, la réhabilitation des moyens de subsistance et la résilience communautaire — en Afrique et en Guinée, à partir de 2026.
Pour l’Afrique, Belém doit marquer la transition d’une diplomatie de plaidoyer à une diplomatie de puissance climatique, apte à influencer les flux financiers, les normes et les marchés. La crédibilité du système climatique mondial se joue à Belém. Si la communauté internationale respecte ses engagements — en matière d’ambition, de financement et de justice — la COP30 sera le tournant indispensable que nous recherchons. Sinon, elle ne sera qu’un autre symbole.
Par Alpha Oumar Kaloga, Négociateur en Chef du Groupe Africain sur les questions Pertes et préjudice et finances climatiques
Share this content: